Le projet SUBLIME, qui a débuté en janvier 2023, étudie le changement qui ébranle l’un des piliers de l’État social dans le monde arabe : les subventions à la consommation, en particulier sur la nourriture et l’énergie. Dans plusieurs pays, la tendance est au basculement de cet ancien modèle de protection sociale à visée universelle vers de nouveaux programmes ciblés de transferts monétaires (cash transfers). Cette tendance a été renforcée par les soulèvements de 2011 et 2019 dans la région, qui ont été interprétés, par de nombreux acteurs (bailleurs internationaux, gouvernants, experts, chercheurs etc.) comme une demande de renouvellement des « contrats sociaux » hérités des indépendances.
Par une approche critique des postulats associés à l’idée de contrat social, à la vision des subventions comme instrument de subordination ou comme fardeau budgétaire, le projet SUBLIME cherche à revisiter les rapports entre ces formes de redistribution sociale (subventions, cash transfers), les processus de réforme, et les dynamiques afférentes de consentement, politisation et mobilisation. Il vise à produire des études empiriques et comparatives dans quatre sociétés post- soulèvement – la Tunisie, l’Égypte, l’Algérie et le Liban. Le projet prend pour objet la « levée » des subventions comme révélateur de la texture politique plurielle des subventions : les réformes engagent des conflits au sein des chaînes d’approvisionnement socio-économiques et des relations bureaucratiques, engendrent des débats politiques ambivalents et des mobilisations sectorielles, et produisent de nouvelles « couches imbriquées » de politiques sociales. Lien vers le site du projet SUBLIME
Programmes sous contrat
Les programmes de recherche sous contrat sont des projets financés dans le cadre de conventions engageant le laboratoire et des institutions publiques ou privées, régionales, nationales ou internationales.
ANR InterMedÉ (2024-2028)

Photos : mosquée Asberi, mosquée Direbelo, cimetière de Messal (Éthiopie) @ Amélie Chekroun
ANR InterMedÉ (2024-2028)
Interactions en Éthiopie médiévale : l'Ifât comme observatoire des relations entre musulmans, chrétiens et non-monothéistes
English below
Coordinatrice : Amélie Chekroun
Membres du projet : Martina Ambu, Deresse Ayenachew, Alebachew Belay, Simon Dorso, Ahmed Hassan, Margaux Herman, Emmie Le Gallès, Anne-Lise Goujon, Héloïse Mercier.
Présentation du projet ANR-24-CE27-4509
Le projet InterMedÉ a pour ambition d’étudier les relations intercommunautaires et interreligieuses dans la Corne de l’Afrique à la fin de l’époque médiévale (XIIIe-XVIe siècles), en réunissant des historien.ne.s et archéologues spécialistes des populations musulmanes, chrétiennes et non-monothéistes. Longtemps étudiées séparément, ces populations partageaient pourtant une communauté de culture, cohabitaient au sein de mêmes territoires, se convertissaient d’une religion à l’autre, échangeaient économiquement, diplomatiquement, maritalement. Le projet vise à mettre en lumière non pas les spécificités propres à chaque population, mais plutôt leurs interactions, leurs traits culturels communs et leurs échanges, afin de concevoir dans une approche holistique, collective et pluridisciplinaire, l’histoire régionale comme un tout pluriel. Cette démarche est rendue aujourd’hui possible grâce au renouveau de ces vingt dernières années des connaissances sur le royaume chrétien et les territoires islamiques, mais aussi les sociétés non-monothéistes de la Corne de l’Afrique au Moyen-Âge.
Le lieu d’observation principal de ces interactions sera la région de l’Ifât, sous autorité non-monothéiste (avant le XIIIe s.), puis islamique (XIIIe-XIVe s.) et enfin chrétienne (XVe-XVIe s.), qui reste tout au long de la période peuplée de musulmans, de chrétiens et de non-monothéistes. Ses grandes cités marchandes, telles que Genbadelo, sont le point de rupture de charge des caravanes reliant le royaume chrétien des hauts-plateaux aux côtes de la mer Rouge : c’est là que s’échangent les ressources de l’arrière-pays (or, ivoire, esclave, etc.) et les biens venus du monde islamique (tissus, parures, etc.). Outre son histoire singulière, la diversité des sources textuelles (en arabe et en guèze, endogènes et exogènes) et archéologiques (dont ses grands sites urbains et funéraires : Nora, Asbäri, Beri-Ifât et Mässal) en font la zone la plus propice pour analyser ces interactions.
Le projet se déploie autour de quatre types d’enquêtes. Le volet « Matérialité » se fonde sur une approche archéologique, afin de repérer les interactions religieuses et culturelles d’un point de vue matériel, avec l’étude archéologique des sites urbains d’Asbäri/Gendabelo et de Beri-Ifât, celle des marqueurs identitaires (funéraire, culture matérielle) et une enquête sur trois trésors de monnaies mamluks, trouvés sur la colline de Rassa, en Ifât. Le volet « Echos dans le temps et l’espace » s’attache à l’étude de trois types de sources exogènes : les textes arabes écrits au Caire aux XIVe et XVe siècles, des Annales écrites en guèze par le moine Pawlos au milieu du XVIe siècle, et les traditions orales et les manuscrits arabes d’Ifât des XIXe et XXe siècles. Le volet « Les femmes, agents d’intégration » permettra d’aborder le rôle des femmes dans la communauté de culture qui unit les populations au-delà des divisions religieuses, s’attachant à l’étude des alliances matrimoniales via les généalogies et à un dossier documentaire exceptionnel sur le rôle des femmes dans les relations diplomatiques après le jihad des années 1530. Enfin, le volet « Géographie historique » croisera données archéologiques et sources textuelles étudiées dans les trois premiers axes, pour repenser les frontières mouvantes entre territoires musulmans, non-monothéistes et chrétiens, les lieux de perméabilité et les espaces tampons. Il ouvrira sur des prospections afin d’élargir la zone d’étude et articuler la région de l’Ifât aux régions environnantes. Il alimentera une cartographie interactive afin d’offrir une vue d’ensemble de la région dans une perspective diachronique.
La journée de lancement d’InterMedÉ se tiendra le 13 novembre 2024, à la Vieille Charité (Marseille) de 10h à 17h.
Interactions in Medieval Ethiopia: Ifât as an observatory of Muslim, Christian and non-monotheistic relations
The InterMedÉ project aims to study inter-community and inter-religious relations in the Horn of Africa in the late medieval period (13th-16th centuries), by bringing together historians and archaeologists specializing in Muslim, Christian and non-monotheistic populations. Although these populations have long been studied separately, they shared a common culture, cohabited within the same territories, converted from one religion to another, and exchanged economically, diplomatically and maritally. The aim of the project is not to highlight the specific characteristics of each population, but rather their interactions, shared cultural traits and exchanges, in order to develop a holistic, collective and multidisciplinary approach to regional history as a plural reality. This approach has been made possible over the last twenty years thanks to the renewal of knowledge about the Christian kingdom and Islamic territories, as well as the non-monotheistic societies of the Horn of Africa in the Middle Ages.
The place to observe these interactions will be the Ifāt region, under non-monotheistic (before the 13th c.), then Islamic (13th-14th c.) and finally Christian (15th-16th c.) authority, which remains populated throughout the period by Muslims, Christians and non-monotheists. Its major trading cities, such as Genbadelo, were the breaking point for caravans linking the Christian kingdom in the highlands to the Red Sea coast: it was here that resources from the hinterland (gold, ivory, slaves, etc.) and goods from the Islamic world (fabrics, ornaments, etc.) were exchanged. In addition to its singular history, the diversity of textual sources (in Arabic and Geez, endogenous and exogenous) and archaeological sources (including its major urban and funerary sites: Nora, Asbäri, Beri-Ifât and Mässal) make it the best place to analyze these interactions.
This project involves four types of investigation. The "Materiality" component is based on an archaeological approach, in order to identify religious and cultural interactions from a material point of view, with the archaeological study of the urban sites of Asbäri/Gendabelo and Beri-If?t, that of identity markers (funerary, material culture) and an investigation of three Mamluk coin treasures, found on the hill of Rassa, in Ifât. The "Echoes in time and space" section focuses on the study of three types of exogenous sources: Arabic texts written in Cairo in the 14th and 15th centuries, Annals written in Geez by the monk Pawlos in the mid-16th century, and Ifât oral traditions and Arabic manuscripts from the 19th and 20th centuries. The "Women, agents of integration" section will address the role of women in the community of culture that unites populations across religious divides, focusing on the study of matrimonial alliances via genealogies and an exceptional documentary dossier on the role of women in diplomatic relations after the jihad of the 1530s. Finally, the "Historical Geography" section will cross-reference the archaeological data and textual sources studied in the first three sections, to rethink the shifting boundaries between Muslim, non-monotheistic and Christian territories, places of permeability and buffer spaces. It will open on to surveys in order to widen the study area and articulate the Ifât region to the surrounding regions. It will feed an interactive cartography to offer an overview of the region in a diachronic perspective.
The InterMedÉ launch day will be held on November 13, 2024, at the Vieille Charité (Marseille, France) from 10am to 5pm.
ANR PredicMO (2024-2028)
PredicMO - Grammaires de la prédication : lexique, cartographie, mise en scène (Moyen-Orient, XIXe-XXIe siècles)
English below
Supervision : Norig Neveu (IREMAM)
Coordination du programme : Marie-Laure Boursin (IDEAS), Sabrina Mervin (IREMAM), Laura Pettinaroli (EFR), Karène Sanchez Summerer (Université de Groningue), Raphael Bories (Mucem), Matthieu Rey (Ifpo).
Carnet hypothèses du programme ANR PredicMO
PredicMO (2024-2028) envisage la prédication comme un élément commun aux trois religions abrahamiques, pourtant sous-étudiée dans sa dimension connectée. Le projet entend établir une « grammaire » commune de la prédication, comprise comme un ensemble de principes, règles, stratégies et modèles, ainsi que leurs variations. Alors que le judaïsme réfute sa vocation universelle, l’islam et le christianisme ont placé la prédication au cœur de leur doctrine. Moteur du « faire croire », la prédication est entendue comme un dispositif incarné par la présence d’un individu ou d’un groupe sur un territoire afin de constituer ou consolider une communauté de croyants. Adoptant une perspective wébérienne, le programme se concentre sur la prédication qui avec l’objectif de convaincre se développe en contexte de crise du religieux, et pas strictement sur la cure des âmes. La prédication en tant que dispositif interne et externe constitutif des expériences de foi a été constamment remodelée depuis la fin du XIXe siècle. PredicMO se concentre sur ses réinventions et redéfinitions contemporaines.
Le programme conçoit le Moyen-Orient comme un espace d’élaboration mais aussi de circulation, d’importation ou d’exportation de modes de prédication. Les territoires concernés par l’enquête (Égypte, Israël, Palestine, Jordanie, Liban, Syrie, Irak) ont tous connu ce phénomène d’ampleur. PredicMO se concentre sur ses réinventions, ses redéfinitions et sur son rôle dans la (re)configuration des environnements religieux et politiques du Moyen-Orient depuis la fin du XIXe siècle. Le programme envisage les influences, émulations et concurrences présentes dans les discours de prédication et leurs stratégies spatiales, avec une attention particulière aux trajectoires transnationales des acteurs, des flux financiers et des idées, aux médias et à la circulation de modèles.
L’équipe de PredicMO se compose de 25 membres d’horizon disciplinaires variés (histoire, anthropologie, science politique, islamologie) et émane d’un partenariat entre trois institutions l’IREMAM, l’École française de Rome (EFR) et l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo) en collaboration avec le Mucem. Le programme de recherche se structure autour de 3 axes :
- Modèles et lexiques de la prédication (coord. N. Neveu).
- Cartographie de la prédication et des prédicateurs : circulation et réseaux transnationaux (coord. K. Sanchez Summerer).
- Mise en scène de la prédication (coord. M-L Boursin et S. Mervin).
Les trois axes s’articulent autour d’une même préoccupation méthodologique : celle d’une approche décloisonnée de l’étude des trois religions monothéistes, par l’intermédiaire d’un objet commun : la prédication, et via l’objectif d’établir une « grammaire » de ce dispositif. PredicMO, au-delà des apports théoriques centraux à l’étude du fait religieux contemporain qu’est l’étude de la prédication, est un espace d’évaluation critique et de réflexion méthodologique. Outre ses apports théoriques, les publications et la valorisation scientifiques, PredicMO aboutira à la mise en ligne d’un dictionnaire des mots de la prédication, d’un catalogue en ligne de ses sources et d’une cartographie des itinéraires des prédicateurs. La collaboration avec le Mucem conduira à l’intégration de certaines pièces de la recherche-collecte aux collections du musée mais également à l’élaboration d’une exposition itinérante.
- 27-29 mars 2024, Mucem, Marseille : colloque de lancement de l'ANR PredicMO, "Les grammaires de la prédication. Lexique, cartographie, mise en scène (Moyen-Orient, XIXe-XXIe siècles)" / International Conference 'Grammars of Preaching: lexis, mapping, staging (Middle East, 19th-21st centuries)'. En partenariat avec l'Ifpo (Institut français du Proche-Orient) le Mucem et l'École française de Rome.
- 14 mai 2024, 14h-16h, CET, MMSH, Aix-en-Provence et en ligne : première séance du séminaire mensuel 2024-2025 « Collecter pour la cartographie et le dictionnaire ».
- 24 juin 2024, 14h-16h, CET, MMSH, Aix-en-Provence et en ligne : seconde séance du séminaire mensuel 2024-2025 « Enquête-collecte et outils partagés ».
- 24 septembre 2024, 13h30-15h30, médiathèque de la MMSH, salle Seurat, Aix-en-Provence et en ligne. Pour cette troisième séance de son séminaire mensuel, PredicMo accueille Matthew Kuiper, historien de l’islam et spécialiste de la da’wa. Sa présentation intitulée "Missionary Preaching in Islam: A Global and Historical Perspective" analysera les différents mécanismes par lesquels l’islam est devenu une religion mondiale, en soulignant l’émergence de mouvements missionnaires modernes.
- 22 octobre 2024, 13h00-15h00, médiathèque de la MMSH, salle Seurat, Aix-en-Provence et en ligne. Séminaire mensuel : « Cartographie de la prédication et des prédicateurs : défis, outils et résultats visuels potentiels ». La séance portera sur le phénomène de cartographie de la prédication et des prêcheurs, ses buts, les enjeux méthodologiques de la collecte des données et les potentiels outils visuels pour traduire ces phénomènes cartographiques. Elle accueillera (en ligne) Pim van Bree (Digital Humanities, Lab1100, La Haye) et Geert Kessels (Historien, Lab1100, La Haye), et présentera les différentes traductions visuelles potentielles pour différentes configurations.
- 27 novembre 2024, 9h00-17h45, MucemLab, Marseille. Journée enquête-collecte PredicMO
- 9 décembre 2024, 13h-16h, médiathèque de la MMSH, salle Seurat, Aix-en-Provence et en ligne. Séminaire mensuel, la séance s’articulera autour de deux temps : un atelier au cours duquel les membres du programme discuteront des enjeux de la cartographie de la prédication à partir de leurs terrains et objets de recherche : que peut-on cartographier ? Quels sont les enjeux de la cartographie pour nos questionnements de recherche ? Ensuite, Thomas Pierret (CNRS, AMU, IREMAM) animera une discussion autour de l'article de Jamal Malik "Fiqh al-Da'wa: the Emerging Standardization of Islamic Proselytism", paru dans Die Welt des Islams, en 2018.
- 13 janvier 2025, formation et séminaire, 10h-15h30, médiathèque de la MMSH, salle Seurat, Aix-en-Provence et en ligne.
- 10h à 12h : formation à Zotero concernant l’usage collaboratif pour l’ANR, animée par Véronique Ginouvès (CNRS, MMSH), Charlotte Gasc (IDEAS) et Annalaura Turiano (IREMAM).
- 13h à 15h30, deux temps d’échange :
1/ Une réflexion sur les objets de la prédication et leur (éventuelle) collecte à partir de nos terrains et objets de recherche.
2/ Une discussion autour de deux articles portant sur les liens entre espace et prédication, qui sera animée par Emir Mahieddin (CéSor).
- 10 février 2025, 13h-15h, médiathèque de la MMSH, salle Seurat et en ligne. Séminaire mensuel : Collaborations entre les programmes ANR et perspectives de travail : la deuxième séance du séminaire PredicMO 2025 est consacrée à une présentation du programme ANR Liv-rel par Anouk Cohen (CNRS, LESC) et Emir Mahieddin (CNRS, CéSor), ainsi que du programme ANR SHS Religis par Norig Neveu (CNRS, IREMAM). Ceci nous permettra de réfléchir aux collaborations potentielles qui pourraient être établies avec PredicMO sous la forme, par exemple, d'ateliers de recherche partagés. Ces présentations seront suivies d'une discussion sur l'article de Adam S. Ferziger, Beyond Bais Ya’akov: Orthodox Outreach and the Emergence of Haredi Women as Religious Leaders (2015) animée par Lisa Antéby-Yémini (CNRS, IDEAS).
- 13 mars 2025, 15h-17h, médiathèque de la MMSH, salle Seurat, Aix-en-Provence et en ligne. Séminaire mensuel. La séance s'articulera autour de deux temps : une présentation de Febe Armanios, (Professeure d’histoire au Middlebury College) autour de ses travaux sur le télévangélisme chrétien au Proche-Orient (résumé et bio en anglais ci-dessous) ; une lecture croisée de trois articles portant sur le « tournant matériel » dans l’étude des religions animée par Annalaura Turiano (IREMAM).
"Salvation through the Screen: The Birth of Arab Christian Televangelism in the Middle East".
This presentation is based on Febe Armanios’s forthcoming book, Satellite Ministries: The Rise of Christian Television in the Middle East (Oxford University Press, 2025). It examines the pioneers of Arab Christian televangelism in the Middle East: Elias Malki (1931-2015) and Nizar Shaheen. During the 1980s, both men preached and broadcast shows on Middle East Television (METV), the region’s first Christian channel established in Israeli-occupied South Lebanon by American evangelical George Otis (1918-2007) and later managed by media mogul Pat Robertson (1930-2023). As a Lebanese-American Pentecostal preacher, Malki introduced American-style televangelism through “The Good News,” a show that offered dramatic faith healing through television screens. Meanwhile, Shaheen, of Palestinian Arab Israeli Christian background, created “Light for All Nations,” which focused on biblical studies and Christian history. Despite their different backgrounds, the two shared similar paths: encounters with Western missionaries led to their “born-again” conversion, and time in North America enhanced their media skills and ties to Western evangelical networks. Though scholarly accounts of religious television in the region often overlook these pioneers, the two men established enduring models that shaped subsequent Christian and Islamic televangelism across the Middle East.
Febe Armanios is Professor of History at Middlebury College. She specializes in the history of Christian communities in the Middle East, especially of Egypt’s Copts, in the study of comparative religious practices, as well as food history and media studies. Armanios is the author of Coptic Christianity in Ottoman Egypt (Oxford UP, 2011) and co-author with Boğaç Ergene of Halal Food: A History (Oxford UP, 2018). She’s now completing a book-length project on the history of Christian television (terrestrial and satellite) in the Middle East (ca. 1981-present) and has also begun research for another book project, which looks at the history of Christian food practices in Ottoman and post-Ottoman regions, including in Egypt, Cyprus, Lebanon, Greece, and Turkey.
- 15 avril 2025, 14h-16h, médiathèque de la MMSH, salle Seurat, Aix-en-Provence et en visioconférence. Séminaire mensuel avec : Yanwar Pribadi (Indonesian International Islamic University) et Stéphane Lacroix (Sciences Po CERI) présenteront leurs recherches en cours sur le thème "Dynamiques de la prédication islamique : regards comparés depuis l'Indonésie". La présentation sera suivie par la discussion d’un article sur les objets religieux dans les musées animée par Marie-Laure Boursin (IDEAS).
Indonesia has long been regarded as a region peripheral to Muslim communities compared to the Middle East, often seen as the ‘center’ of Islam. One possible cause of this neglect is the fact that Indonesia has for centuries seen syncretic manifestations of Islamic rituals, which do not correspond to the ‘standard’ image of Islam. Nevertheless, things have changed, firstly after the global Islamic revivalist period of the 1970s and secondly since the collapse of the authoritarian New Order administration in 1998. These periods have caused some Muslims in Indonesia to embrace more conservative and (in their view) ‘purer’ interpretations of Islam. Religious diversity in today’s Indonesia is frequently set against the background that some Indonesian Muslims have become more self-consciously Islamic – an Islamization that is both momentous and ongoing. This process has come along with a widening and fortification of religious observance.
Our presentation will attempt to address issues from the Indonesian case that seem relevant to the Predicmo project. Stéphane Lacroix will make initial comparative remarks, reflecting on his previous studies on the Middle East and his current work on Indonesia. Yanwar Pribadi will then more specifically address the ongoing transformations of Indonesian urban and rural religiosity, through a study of the pengajian - Islamic study groups that have become a prime preaching venue across the country.
Yanwar Pribadi is a professor of anthropology of religion at Indonesian International Islamic University (UIII) and at UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia. He graduated from Leiden University (MA and PhD). Yanwar Pribadi is the author of Islam, State and Society in Indonesia: Local Politics in Madura (Routledge, 2018) and of numerous articles in edited volumes, encyclopaedias, and journals. His research interests include Muslim politics and expressions, religious networks, contemporary Islamic history, and citizenship.
Stéphane Lacroix is an associate professor of political science at Sciences Po, a senior researcher at Sciences Po’s Centre de Recherches Internationales (CERI) and the co-director of Sciences Po's Chair for the study of religion. His work deals with religion and politics, with a focus on the Gulf and Egypt. He is now starting a new project on Indonesia. He is the author of Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia (Harvard University Press, 2011), Saudi Arabia in Transition: Insights on Social, Political, Economic and Religious Change (Cambridge University Press, 2015, with B.Haykel and T. Hegghammer), Revisiting the Arab Uprisings: The Politics of a Revolutionary Moment (Oxford University Press, 2018, with Jean-Pierre Filiu) and more recently Le crépuscule des saints: histoire et politique du salafisme en Egypte (CNRS Editions, 2024, forthcoming in English with Columbia University Press).
- 10 juin 2025, 13h30-16h, médiathèque de la MMSH, salle Seurat, Aix-en-Provence et en visioconférence. Séminaire mensuel - “Questions of truth: Comparing within and across religious missions” - Mathijs Pelkmans, London School of Economics and Political Science.
La présentation sera suivie par la discussion d'un chapitre issu de l'ouvrage collectif Digital Judaism: Jewish Negociations with Digital Media and Cultures (Routledge, 2015), animée par Sébastien Tank-Storper (CéSor).
In this paper I draw on fieldwork I carried out in the Caucasus and Central Asia, where I studied Orthodox Christian, Tablighi Muslim, and Evangelical missions, and the dynamics of religious conversion and renewal propelled by them. But instead of focusing on my empirical findings, I will use this paper to explore possibilities of comparison within and across religious missions, starting by acknowledging the formidable obstacles involved. This includes the contested nature of concepts and terms on which such comparative work could be built. My interlocutors in Kyrgyzstan and Georgia rejected the notion of ‘religion’, balked at the idea of ‘conversion’, and denied that they were ‘missionaries’. But while such terms are clearly problematic, adopting my interlocutors’ preferred alternatives would create its own problems, such as potentially confirming ‘Christian truth’ over ‘Muslim corruption’ or vice versa. But instead of attempting to solve this conundrum by developing more ‘neutral’ terms, I will instead allow the explore the biases and disagreements themselves. By tracing disagreement and dissonance in relation to such terms, I hope to illuminate the ideas of truth that speak through them and shed light on the possibilities and impossibilities of comparison within and across religious missions.
Mathijs Pelkmans is Professor of Anthropology at the London School of Economics and Political Science. A specialist of the Caucasus and Central Asia, his work explores specifically the intersection of power, knowledge, and difference. This is true of his first monograph Defending the Border: Identity, Religion, and Modernity in the Republic of Georgia (2006) which traced the social biography of the Iron Curtain, as well as his second monograph Fragile Conviction: Changing Ideological Landscapes in Urban Kyrgyzstan (2017) which explored the fate of religious and secular ideologies in contexts of intense uncertainty. His interest in the shadowy sides of knowledge is especially visible in the edited collections Ethnographies of Doubt (2013), ‘Wilful Blindness’ (2020, with J. Bovensiepen), and How People Compare (2022, with H. Walker), and is central in his ongoing work on suspicion and conspiracy theorising.
- May 26–27, 2025, Institut Français in Amman, Jordan. International Conference - Crises and Preaching: Lexis, framing, timings, 19th‒21st century in the Middle East
- 23 septembre 2025 :
- 10h00-12h00, médiathèque de la Mmsh, salle Seurat, Aix-en-Provence et en visioconférence. “Preaching and Media”, Jakob Skovgaard-Petersen (University of Copenhagen).
- 13h30-17h30, médiathèque de la Mmsh, salle Seurat, Aix-en-Provence. Atelier de formation au son (Nicolas Puig, IRD ; Séverine Gabry-Thienpont, CNRS).
“Preaching and Media” - Jakob Skovgaard-Petersen (University of Copenhagen)
Taking my cue from the project focus on preaching as “(re-)faire croire” in a time characterized by « la sainte ignorance», I would like to begin by discussing whether there is a “holy ignorance” in the Arab World. In many ways it seems to be the opposite; still, Olivier Roy has a point. Via a short recapitulation of my own scholarly trajectory, I’ll then discuss the subject of fatwas, the role of the ulama and the mediatization of Muslim societies. On fatwas, I would like to discuss the enormous amount of fatwas, “fatwa chaos”, and the responses to it by a number of scholars and, increasingly, states. On the ulama, I would like to discuss their search for a new role, and what they have found. From a major crisis in the first half of the 20th century the ulama have managed to reassert themselves as custodians, not just of Islamic law and learning, but of social and cultural identity and norms. On media, I would address the issue of mediatization, religious programming, and provide an overview of the types of programs, the new da`iya, and the ulama. A final theme will be the more (or less) subtle negotiations on the role of Islam in historical and religious dramas.
Jakob Skovgaard-Petersen is Professor of Arabic and Islamic Studies at the University of Copenhagen. His field of research is contemporary Islam in the Arab World, more specifically the establishment of a modern public sphere and the role Islam on Arab television, for instance in the long TV-dramas aired during Ramadan. Another field of interest is the role of the Sunni ulama in Arab states, societies and media, the ulama institutions such as the madrasa and the muftiship. A third field is the interpretation of the life of the Prophet Muhammad in Muslim and non-Muslim traditions. His books and edited books include : Muhammad of the Muslims – and of everyone else. Copenhagen: Gyldendal, 2020 (in Danish), Arab Media Moguls. Eds. Della Ratta, Sakr & Skovgaard-Petersen, London: I.B. Tauris, 2015 ; The Global Mufti. The Phenomenon of Yusuf al-Qaradawi. Eds. Gräf & Skovgaard-Petersen. Hurst/Columbia University Press, 2009.
- 16-20 septembre 2025, exposition « Représenter la Terre Sainte : approches visuelles d’un territoire en mouvement (1920-1940) » - Festival des Sciences et des Arts, Aix-en-Provence, Aubagne et Marseille.
- 24 septembre 2025, 9h30-17h00, médiathèque de la Mmsh, salle Seurat, Aix-en-Provence. Contact : Annalaura Turiano
Atelier de l'ANR PredicMO - Archives et ethnographie du Web
9h30-13h00 - Atelier - Archives et ethnographie du Web (Véronique Ginouvès, MMSH ; Sophie Gebeil, TELEMMe)
14h30-17h00 - Réunion du programme et des axes
- 16-20 septembre 2025, exposition « Représenter la Terre Sainte : approches visuelles d’un territoire en mouvement (1920-1940) » - Festival des Sciences et des Arts, Aix-en-Provence, Aubagne et Marseille.
- 13 octobre 2025, 13h00-15h00, médiathèque de la Mmsh (Aix-en-Provence), salle Seurat et en ligne.
Thibaud LAVAL (chercheur associé à l'IREMAM et à l'Ifpo) présentera une communication intitulée « Les origines de l’islamisme chiite en Irak et en Iran et la question de l’attentisme clérical : nouvelles perspectives (1945-1955) ».
La présentation sera suivie par la lecture critique de l’article de Claire Poirier « Ces artefacts ont un langage bien à eux : collections muséales, propriété et politiques de la différence», Anthropologie et sociétés, vol. 38, n°3, 2014, p. 61-77, proposée par Marie-Laure Boursin (IDEAS).
Cette intervention présente les premiers résultats de recherches conduites depuis plusieurs mois sur les origines doctrinales, sociales et politiques de l’islamisme chiite en Iran et en Irak dans une perspective croisée. Thibaud Laval présentera brièvement l’histoire des « Fadāʾiyyān-e Islām », fondés dans les derniers mois de l’année 1945, en essayant de mettre au jour la structure transnationale de cette organisation active en Iran mais aussi en Irak. À l’appui de plusieurs centaines de documents internes, de mémoires et de rapports des services de renseignement iraniens, il interrogera la nature des relations des Fadāʾiyyān avec les autorités religieuses chiites et les raisons pour lesquelles certains oulémas se sont vivement opposés à cette organisation tant à Najaf qu’à Qumm. Bien que les Fadāʾiyyān soient connus pour les assassinats politiques qu’ils commirent en Iran entre 1945 et 1955, il interrogera les autres modalités d’action de cette organisation en répondant à la question suivante : s’agissait-il d’une organisation religieuse prosélyte ayant cherché à influencer et recruter au sein des séminaires chiites réputés pour leur « quiétisme » ?
Diplômé d’un Master en islamologie (EPHE) et titulaire d’un doctorat en histoire (2024, EHESS), Thibaud LAVAL est postodoctorant associé à l’IREMAM et à l’Ifpo et membre de PredicMO. Ses recherches portent sur l’islamisme chiite ainsi que l’histoire des villes saintes en Irak (Najaf et Karbala notamment). Dans le cadre de PredicMO, il s’intéresse à l’évolution du dispositif de l’autorité religieuse chiite au cours du XXe siècle, et en particulier au rôle des agents dont le réseau se développe dans tout l’Irak à partir des années 1950.
14h30-17h00 - Réunion du programme et des axes
- 18 novembre 2025, 14h-16h, médiathèque de la Mmsh, salle Seurat, Aix-en-Provence et en visioconférence.
Chantal Verdeil - Prêcher via le théâtre ? Les représentations théâtrales dans les écoles missionnaires à la fin de l’époque ottomane
On sait quelle place occupe le théâtre dans l’éducation jésuite. Ceux établis à Beyrouth à la fin du XIXe siècle n’ont pas failli cette tradition et très vite une scène est aménagée dans l’enceinte de l’Université Saint-Joseph qui accueille surtout des garçons âgés de 8 à 15 ans. Les représentations que les élèves et leurs professeurs y donnent ont contribué à la naissance du théâtre à l’occidentale dans le monde arabe. Mais pour les jésuites, elles ont surtout une dimension pédagogique. À travers pièces, dialogues et discours, ils indiquent à leurs élèves la voie à suivre : la fidélité à la foi catholique et romaine… jusqu’au martyre et à la mort.
Chantal Verdeil est professeur d’histoire du monde arabe contemporain depuis septembre 2018 à l’Inalco. Ses recherches portent sur les transformations religieuses et sociales du Proche-Orient contemporain, scrutées à travers l’histoire des missions et celles de l’éducation. Chantal Verdeil a publié Les débuts de la mission jésuite de Syrie (1831-1864), (2011), ouvrage tiré de sa thèse. Elle a coordonné un numéro de la revue Histoire de l'éducation consacré aux questions d’enseignement au Moyen-Orient et un ouvrage issu d’un colloque sur les femmes missionnaires dans les mondes musulmans. Elle prépare en outre la publication de l’inédit de son dossier d’HDR, qui porte sur l’histoire de l’Université Saint-Joseph, université catholique et francophone fondée en 1875. Elle a écrit avec Catherine Mayeur-Jaouen et Anne-Laure Dupont deux manuels d’histoire du Moyen-Orient parus chez A. Colin en 2011 et 2016 (nouvelle édition 2023).
- 15 décembre 2025, 13h00-15h00, Mmsh, salle 102, Aix-en-Provence et en visioconférence.
Avec : Karène Sanchez (Université de Groningue) et Norig Neveu (CNRS, IREMAM), Prêcher en contexte colonial : une approche comparée des expériences catholiques en Palestine et en Transjordanie (1930-1950).
L'intervention de Karène Sanchez Summerer et de Norig Neveu portera sur les formes et la reconfiguration de la prédication (au sens large) au sein de l'Église catholique en Palestine et dans l'émirat de Transjordanie entre les années 1930 et 1950, à partir des archives du Vatican (Congregazione Orientale), ainsi que celles des Églises locales. Elles examineront la manière dont certaines institutions éducatives et religieuses catholiques ont contextualisé, utilisé ou délaissé la prédication pour naviguer à travers les tensions politiques et religieuses de l'époque, y compris la question palestinienne et les relations entre chrétiens, juifs et musulmans. Comment, durant cette période de l'entre-deux-guerres, les territoires sous mandat britannique sont-ils devenus de nouveaux fronts missionnaires ? Le séminaire mettra en lumière les stratégies de prédication, les différences avec les communautés de religieux d’autres confessions chrétiennes, les défis pastoraux et les interactions politiques des acteurs religieux de cette période cruciale.
Liste de diffusion : predicmo[at]services.cnrs.fr
PredicMO - Grammars of preaching: lexis, mapping, staging (Middle East, 19th-21st centuries)
PI: Norig Neveu (IREMAM)
Core team: Marie-Laure Boursin (IDEAS), Sabrina Mervin (IREMAM), Laura Pettinaroli (EFR), Karène Sanchez Summerer (Université de Groningue), Raphael Bories (Mucem), Matthieu Rey (Ifpo).
PredicMO (2024-2028) argues that preaching is a common element between the three Abrahamic religions, but nevertheless remains understudied in its connected and dynamic dimensions. The project seeks to establish a common ‘grammar’ of preaching, understood as a set of principles, rules, strategies, and models, along with their variations studied closely in the texts and fields. Whereas Judaism refutes its universal vocation, Islam and Christianity have placed preaching at the heart of their doctrine. Different and often competing actors and models of preaching have been deployed. The driving force behind "making people believe", preaching is understood as a mechanism embodied in the presence of an individual or a group in a given territory in order to build or consolidate a community of believers. Adopting a Weberian perspective, the programme focuses on preaching, which, with the aim of convincing, develops in a context of religious crisis, and not strictly on the cure of souls. Since the end of the nineteenth century, preaching as an internal and external device constitutive of faith experiences has been constantly remodelled. PredicMO focuses on its contemporary reinventions and redefinitions.
The programme sees the Middle East as a place where modes of preaching are not only developed but also circulated, imported and exported. The territories covered by the study (Egypt, Israel, Palestine, Jordan, Lebanon, Syria and Iraq) have all experienced this widespread phenomenon. PredicMO focuses on its reinventions, redefinitions and role in the (re)configuration of religious and political environments in the Middle East since the end of the nineteenth century. The programme considers the influences, emulations and competitions present in preaching discourses and their spatial strategies, with particular attention to the transnational trajectories of actors, financial flows and ideas, the media and the circulation of models.
The PredicMO team consists of 25 members, with a multidiscipliary background (history, anthropology, political science, Islamology) and partner of three institutions: IREMAM, the École française de Rome (EFR) and the Institut français du Proche-Orient (Ifpo). It collaborates with the Mucem museum. The research programme is structured around 3 subprojects:
- Models and lexis of preaching (coord. N. Neveu).
- Mapping preaching and preachers: transnational circulation and networks (coord. K. Sanchez Summerer).
- Staging preaching (coord. M-L Boursin et S. Mervin).
The three subprojects share the same methodological concern: a decompartmentalised approach to the study of the three monotheistic religions, via a common object: preaching, Its objective is to establish a 'grammar' of preaching. In addition to the theoretical contributions that the study of preaching makes to the study of contemporary religion, PredicMO provides a forum for critical evaluation and methodological reflection.
Its outputs will be a theoretical contribution to the study of preaching, publications and social impact, PredicMO will result in the online publication of a dictionary of the words used in preaching, an online catalogue of its sources and a mapping of preachers' itineraries. The collaboration with the Mucem will result into the integration of certain items from the research-collection into the museum's collections, as well as the development of a travelling exhibition.
27-29 March 2024, Mucem, Marseille: ANR PredicMO launch conference, "Les grammaires de la prédication. Lexique, cartographie, mise en scène (Moyen-Orient, XIXe-XXIe siècles)" / International Conference 'Grammars of Preaching: lexis, mapping, staging (Middle East, 19th-21st centuries)'. In partnership with Ifpo (Institut français du Proche-Orient), Mucem and the École française de Rome.
14 May 2024, 2pm-4pm, CET, MMSH, Aix-en-Provence and Online: first session of the 2024-2025 monthly seminar 'Collecting for mapping and for the establishment of the dictionary of preaching'.
26 June 2024, 2pm-4pm, CET, MMSH, Aix-en-Provence and Online: second session of the 2024-2025 monthly seminar "Collecting surveys and shared tools".
24 September 2024, 1:30 p.m.-3:30 p.m., MMSH media library, Seurat room, Aix-en-Provence and Online. For this third session of its monthly seminar, PredicMo welcomes Matthew Kuiper, historian of Islam and specialist in da’wa. His presentation entitled “Preaching in context: Multidisciplinary and connected approaches” will analyze the different mechanisms by which Islam became a global religion, highlighting the emergence of modern missionary movements.
22 October 2024, 1pm-3pm, MMSH, Aix-en-Provence and Online. "Mapping Preaching and Preachers: challenges, tools and potential visual output". The session will look at the phenomenon of mapping preaching and preachers, its goals, the methodological challenges of collecting data and the potential visual tools for translating these cartographic phenomena. It will welcome (online) Pim van Bree (Digital Humanities, Lab1100, The Hague) and Geert Kessels (Historian, Lab1100, The Hague), and will present the various potential visual translations for different settings.
Mailing list: predicmo[at]services.cnrs.fr
ANR SUSTHERIT (2024-2027)
Patrimoine urbain historique des centres villes. Stratégies pour un parc immobilier européen durable
Coordination : Saïd Belguidoum
Le projet SUSTHERIT (2024-2027) se fixe comme objectif principal de montrer comment les logements historiques, considérés comme un élément précieux du patrimoine culturel, peuvent être intégrés à l'action climatique urbaine, en prenant en compte à la fois les opportunités et les bonnes pratiques ainsi que les obstacles sociaux, économiques et politiques. Le parc logement des centres historiques des villes européennes possède des qualités urbanistiques et architecturales qui lui font jouer un rôle considérable dans l'identité de ces villes. Souvent reconnu comme tel dans les politiques d'aménagement, il constitue un patrimoine matériel et immatériel et est souvent au cœur de la vie urbaine. Cependant, la pression du marché et les stratégies d'adaptation aux effets du climat proposées par les villes et les gouvernements nationaux menacent ce patrimoine.
Le sous-investissement dont a souffert trop longtemps ce parc logement fait qu’il est souvent coûteux et techniquement difficile de le réhabiliter, et lorsque de telles mesures sont prises elles entrainent des dynamiques de spéculation immobilière, de gentrification et de déplacement des populations. La disparition de ce patrimoine culturel est un risque réel auquel sont confrontées les villes européennes et aura comme conséquence une nouvelle recomposition sociologique des centres-villes.
La recherche se concentrera sur la mobilisation des connaissances formelles et informelles existantes sur ce patrimoine historique et sur les pratiques quotidiennes des habitants et leurs stratégies d'adaptation au changement climatique. En adoptant une approche transnationale et en s’appuyant sur une expertise transdisciplinaire, le projet proposera une analyse du rôle des différentes constellations d'acteurs, des réglementations et des structures de propriété du parc immobilier dans quatre contextes urbains différents - Marseille, Vienne, Prague et Glasgow – avec comme finalité la création d’une boîte à outils méthodologiques combinant des expériences paneuropéennes et qui contribuera à l’élaboration de stratégies et de pratiques locales permettant d’atténuer les effets du changement climatique sur le parc immobilier historique.
Le programme Sustherit est porté par un consortium constitué de 5 équipes de recherche des différentes villes européennes regroupant différents profils disciplinaires (sociologues, urbanistes, géographes, économistes, architectes) :
- Vienne - Institut de recherche urbaine et régionale de l'Académie autrichienne des sciences (ISR-OeAW) coordination du consortium.
- Marseille - L'Institut de Recherche et d'Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans (IREMAM) de l'Université Aix-Marseille. Le LIEU et l’AGAM.
- Prague - Université Charles, Faculté des sciences, Département de géographie sociale et de développement régional et le Centre CVMR.
- Glasgow - L'Institute for Future Cities (IFC).
- Zurich - La chaire de construction, de patrimoine et de conservation de l'ETH Zurich.
Le programme de recherche se structure autour de 5 axes. Chaque axe étant coordonné par une des équipes du consortium.
1- Stratégies et politiques municipales en matière de changement climatique, de logement et de patrimoine.
2- Structure et dynamique du parc de logements historiques.
3 -Patrimoine et transformation durable.
4- Évaluation des meilleures pratiques pour les actions de lutte contre le changement climatique et le test des bâtiments.
5- Boîte à outils évolutive pour la transformation durable du patrimoine.
Les cinq axes s’articulent autour d’une même préoccupation méthodologique : celle d’une approche décloisonnée permettant sur la base des résultats des 5 axes d’élaborer une boîte à outils paneuropéenne (méthodologie).
ANR SUBLIME (2023-2027)
Subsidies Lift in the Middle East and North Africa: Unveiling the Politics of Welfare in Post-Uprising Societies/La levée des subventions au Maghreb et au Moyen-Orient : rapports politiques, transformations de l’État et protection sociale après les soulèvements arabes
Coordonnée par Marie Vannetzel, le projet est co-porté par l’IREMAM à Aix-en-Provence (UMR7310), le CERAPS à Lille (UMR 8026) et l’IFPO à Beyrouth (UAR 3135), et se terminera en 2027.
Membres de l’équipe : Marie Vannetzel (CNRS-IREMAM, coordinatrice générale), Myriam Catusse (CNRS, responsable IFPO), Amin Allal (CNRS, responsable CERAPS), Eric Verdeil (FNSP), Assia Boutaleb (Université Paris 1 Sorbonne), Pierre France (OIB).
La recherche par l’écoute (2021-2025)
Photo @ Peter Sinclair
« Expérimentations artistiques et dispositifs critiques »
Coordination : Cédric Parizot (IREMAM) et Peter Sinclair (Locus Sonus)
Depuis 2021, en collaboration avec Locus Sonus, unité de recherche de l'Ecole supérieure d'art d'Aix-en-Provence Félix Ciccolini, l’Institut de Recherche et d’Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans (CNRS/Aix Marseille Université) a lancé le programme « La recherche par l’écoute : expérimentations artistiques et dispositifs critiques. » Dans le cadre de ce nouveau partenariat, inscrit dans l’accord cadre entre le CNRS et le ministère de la Culture, l’enjeu pour les artistes et les chercheurs, sera d’expérimenter des approches du monde, articulées autour du son, de la vision et du tactile.
Cette collaboration a pour objectif de développer une réflexion pratique autour des modes de perception et de conceptualisation des espaces et des limites. Elle s'appuiera sur l'exploration de dispositifs collaboratifs et expérimentaux de captation et d'écoute. Ceci permettra de s’interroger sur les caractéristiques des espaces sonores ainsi que sur les dispositifs et modalités à travers lesquels les chercheurs accèdent à leurs terrains d'enquête. Plus largement, ce partenariat permettra d’amorcer une réflexion critique autour des modes de conceptualisation et de construction de nos objets de recherche, artistiques et scientifiques. Elle offrira ensuite la possibilité de redéployer ces objets pour les envisager à travers des approches et des dispositifs renouvelés.
Au cours de ces deux premières années, ces expérimentations porteront autour du thème des espaces et des limites. Elles se construiront en articulant des axes de recherche propres à chacune des unités, par exemple, l’axe « Audio en réseau et espaces sonores (Nouveaux auditoriums) » de Locus Sonus, « Circulations, espaces, régulations » et “Recherche, arts et pratiques numériques” de l’Institut de Recherche et d’Etudes sur les Mondes Arabes et Musulmans (IREMAM).
LITTÉRATURES POPULAIRES DU LEVANT - LiPoL (2020-2025)
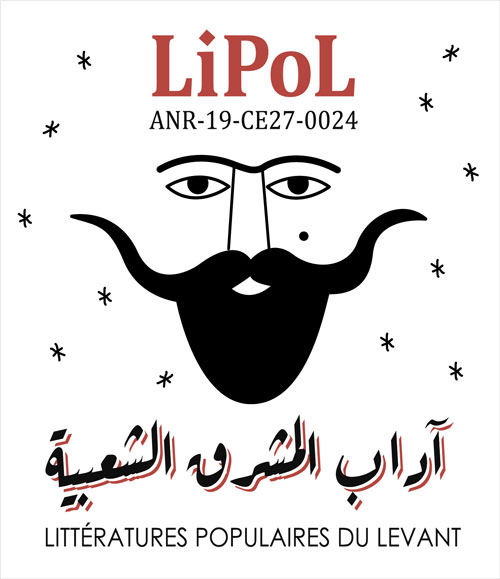
Photo © LiPol
Le programme Littératures Populaires du Levant (LiPoL), coordonné par Iyas Hassan et financé par l’Agence Nationale de la Recherche (projet ANR-19-CE27-0024), est un programme de recherche pluridisciplinaire portant sur un vaste ensemble de manuscrits du Roman de Baybars (la « Sîra », Sīrat al-Malik al-ẓāhir Baybarṣ) et leur édition partielle aux Presses de l’Ifpo. Composé de plus de dix millions de caractères, ce texte est le plus grand corpus jamais publié en moyen-arabe et constitue un objet de recherche unique dans ce domaine.
Les manuscrits, collectés par des chercheurs de l’IFEAD à Damas dans les années 1990 et 2000, ont été numérisés par photographie à la fin des années 2000. C’est ainsi que LiPoL dispose maintenant de plus de 30.000 fichiers, représentant environ 60.000 pages de cahiers utilisés par les conteurs des cafés de Damas au cours du XXe siècle.
En se repenchant sur ces cahiers, les membres du programme se sont dotés de plusieurs objectifs pour valoriser ce riche patrimoine culturel et scientifique : relancer la recherche dans le domaine de la littérature populaire levantine, mettre en libre accès la version numérique des manuscrits et leur édition numérique, mais aussi soutenir et accompagner les jeunes conteurs du Proche-Orient qui font revivre la tradition du conte oral.
Cinq pôles académiques travaillent en coordination pour l’avancée du programme : les universités Lyon 2 et Lyon 3, AMU, l’Inalco et l’Ifpo
Composé de plus de dix millions de caractères, ce texte est le plus grand corpus jamais publié en moyen-arabe et constitue un objet de recherche unique dans ce domaine. Plusieurs axes de recherches seront développés :
- un axe numérique, sous la responsabilité de Jean-Christophe Peyssard, qui visera à faire une édition numérique critique du texte et à créer un instrument de recherche des manuscrits numérisés, mis en lien avec un outil de transcription collaborative en libre accès,
- un axe linguistique, sous la responsabilité d’Iyas Hassan, qui s’attachera à l’étude du moyen-arabe, forme particulière d’arabe utilisée pour le récit de la Sîra,
- un axe socio-historique, sous la responsabilité de Philippe Bourmaud, qui mettra en lumière les liens entre les thématiques abordées par le récit et le public auquel il s’adresse,
- un axe esthétique, sous la responsabilité d’Iyas Hassan, consacré aux aspects proprement littéraires du texte, de ses origines médiévales à sa narration contemporaine. Consacré aux aspects proprement littéraires du texte et à des problématiques relevant de l’histoire de la littérature ou de sa pratique contemporaine, cet axe permettra d’envisager la Sīra comme une œuvre composite et d’examiner ses différents points d’ancrage dans le paysage littéraire arabe médiéval, moderne et contemporain. Ainsi, l’axe Esthétique prendra en charge un ensemble de questions concernant des phénomènes d’intertextualité, la datation des manuscrits et des épisodes et la place des romans populaires dans les sociétés arabes d’aujourd’hui. On s’attachera particulièrement à établir certaines correspondances entre la matière narrative utilisée par le Roman de Baybars et les Mille et Une Nuits, et, plus largement, la littérature arabe médiane, qui regroupe les Nuits et des recueils analogues souvent inexplorés. Membres de l’axe : Mohamed Bakhouch, professeur des universités (IREMAM - Aix-Marseille Université) ; Georges Bohas, professeur des universités (ENS Lyon) ; Simon Dubois, chercheur MEAE (Ifpo) ; Najla Nakhlé-Cerruti, chercheure (Ifpo) ; Aboubakr Chraïbi, professeur des Universités (Inalco) ; Iyas Hassan, professeur des Universités (Sorbonne Université) ; Rosa Pennisi, post-doctorante (IREMAM - CNRS).
